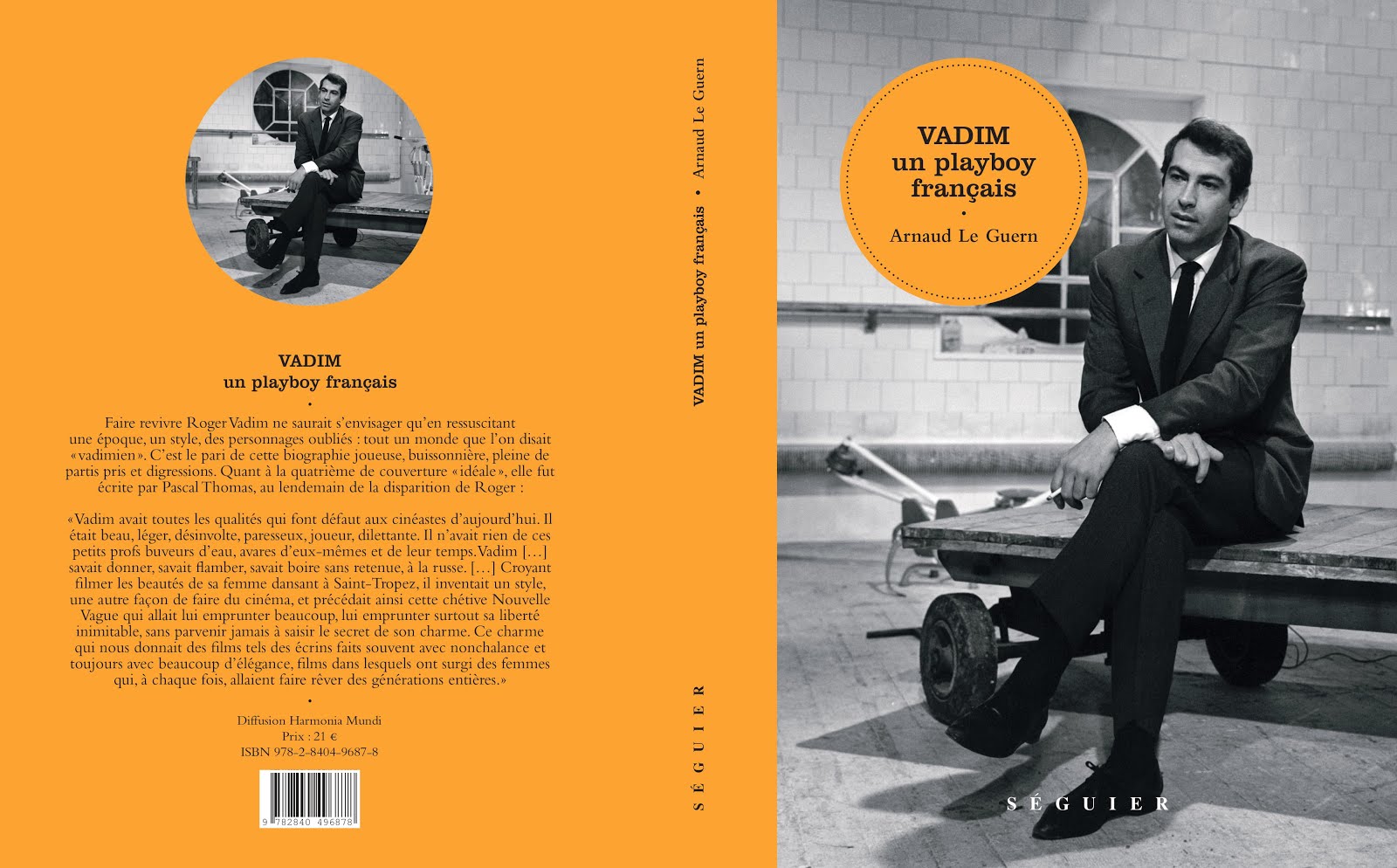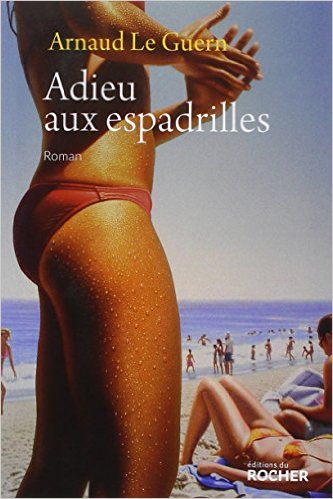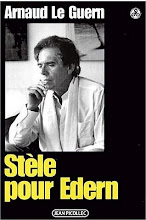Accoudée au zinc, cheveux noirs, oeil noir, caraco noir et pantalon en toile blanche, c’est une danseuse. J’ai l’œil qui ne trompe pas. Je ne fréquente que ces oiseaux de nuit. Et j'ai en bouche des mots qui tuent, des mots céliniens qui révèlent un noyau d'aurore : «
Dans une jambe de danseuse le monde, ses ondes, ses folies, ses voeux sont inscrits !... Jamais écrits !... Le plus nuancé poème du monde !... émouvant ! Le poème inouï, chaud et fragile comme une jambe de danseuse en mouvant équilibre est en ligne, aux écoutes du plus grand secret, c'est Dieu ! »
_ Qu'est-ce que c'est ?
_ C’est une ode au compas des jambes, à la vista des cuisses, à leur forme, à leur mousse de lin, au galbe de leur lame.
C’est une danseuse. Elle me répond sans un mot de trop, d’une langue qui perce entre ses dents.
_ La grâce ?
_ Je la touche dès qu’elle se cache.
_ C’est-à-dire ?
_ La grâce, c’est l’absolu dans sa chair, dans son cache-cœur de roches fendues jusqu’à l’os. Quand elle disparaît, effarouchée par le bruit des ricanements du dehors, je lui offre mes entrechats, et elle revient, se pose de nulle part et m’embrasse sur les paupières.
Alors qu’elle parle, j'imagine un palais, un théâtre, un opéra.
La scène partout présente, le parquet lustré, les miroirs déformants.
La salle de répétition, à laquelle mène un couloir encombré de sacs à dos et de peluches porte-bonheur.
Les pointes qu’on enfonce, qu’on tord sous la commode, et les larmes.
Les pointes qu’on caresse, le rose des sucres d’orge et des tutus, l’étoffe au plus près du corps.
Une jambe qui s’élève, se plie, se déplie, effleure la barre.
J'imagine le rimmel autour des yeux, une chatte, une Catwoman en fourreau de peau. J'imagine la cigarette pour se perdre, pour oublier, pour respirer, anéantir la lourdeur du temps.
Cheveux noir, oeil noir, caraco noir, c'est une danseuse. Personne ne peut s’accaparer l’espace avec une telle majesté des gestes. Les murs du troquet se réduisent aux marques secrètes qu'elle dépose sur les paumes de chaque courant d'air. Son corps est habité, hanté, ensorcelé par une absolue classe héritée des dieux. Un poignet, un coude, une épaule bougent, les jambes se cherchent, se trouvent, se croisent, dénouent leur foulard : l’extase est immédiate, l'extase arrache des soupirs aux offenses effacées. Elle prend son verre : je chavire. Elle le ramène à ses lèvres : je sombre. Elle fond dedans: je bois la tasse.
Accoudée au zinc, elle déguste un verre de Sancerre. Dans sa main droite, une marlboro légère et ses colliers de brouillard. Elle laisse infuser les tracas, les coups bas. Elle s'est posée là pour rebondir, pour s'envoler. Belle sur scène, elle le serait filmée par Chabrol ou par Brisseau. Qu’ils y pensent.
 Un recueil de Jacques Perret – introuvable aujourd’hui – s’appelle Le vilain temps. Sorti en 1960, il rassemble les papiers pro-Algérie française de Perret et ses carabineries drôlatiques et vénéneuses contre le pouvoir des lâcheteux en place, gaullien ou autre : « Si, reconnaissant mes torts, je n’hésitais pas aujourd’hui à déclarer devant vous que le général de Gaulle est à mes yeux désormais toute loyauté, franchise et droiture, le tribunal serait fondé à croire que je me moque de lui… » Une parole frondeuse, condamnée alors pour "offense au chef de l'Etat", qui ne passerait plus par les tristes temps où nous vivons. Remplacez de Gaulle par Nicolas le petit, John Biroute ou Ségogo : la campagne prendrait des couleurs, des coups de soleil. L'horreur pour les tièdes !
Un recueil de Jacques Perret – introuvable aujourd’hui – s’appelle Le vilain temps. Sorti en 1960, il rassemble les papiers pro-Algérie française de Perret et ses carabineries drôlatiques et vénéneuses contre le pouvoir des lâcheteux en place, gaullien ou autre : « Si, reconnaissant mes torts, je n’hésitais pas aujourd’hui à déclarer devant vous que le général de Gaulle est à mes yeux désormais toute loyauté, franchise et droiture, le tribunal serait fondé à croire que je me moque de lui… » Une parole frondeuse, condamnée alors pour "offense au chef de l'Etat", qui ne passerait plus par les tristes temps où nous vivons. Remplacez de Gaulle par Nicolas le petit, John Biroute ou Ségogo : la campagne prendrait des couleurs, des coups de soleil. L'horreur pour les tièdes !











 Je me souviens , c'était l'été dernier. 30 degrés et des poussières, l’ombre se planque. En terrasse, je bois des demis, allume une bastos et goûte les mots de Jérôme Leroy.
Je me souviens , c'était l'été dernier. 30 degrés et des poussières, l’ombre se planque. En terrasse, je bois des demis, allume une bastos et goûte les mots de Jérôme Leroy.