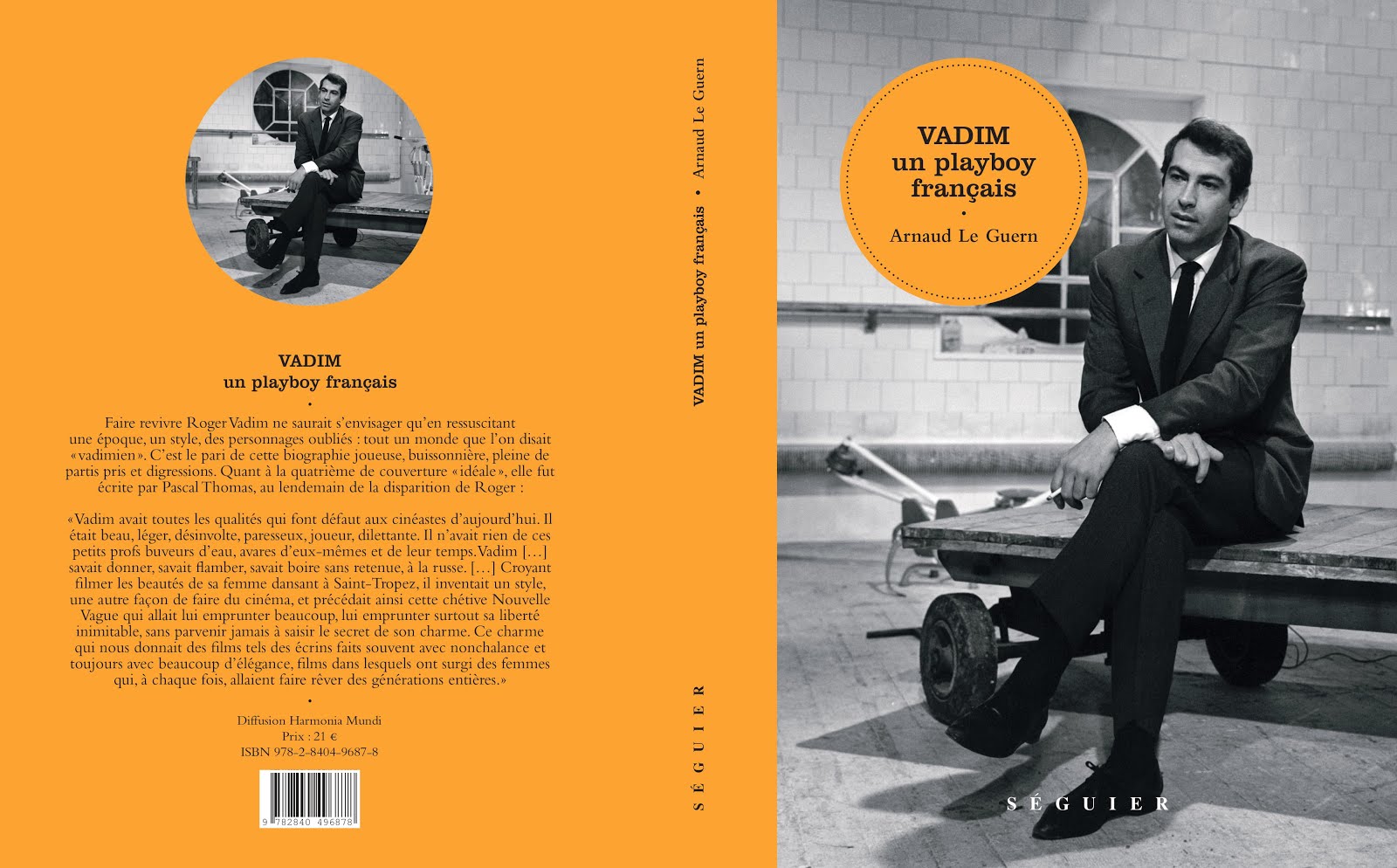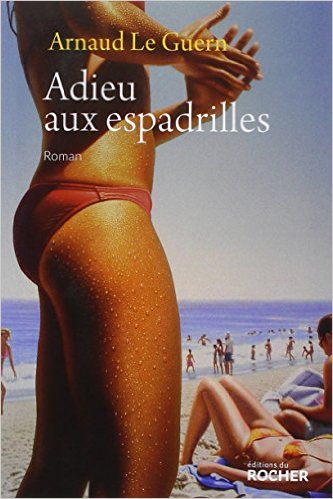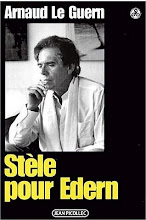A Cabourg, Jean revient sur les pas des étés de sa jeunesse. Il a laissé femme et enfants à Paris le temps d’un vagabondage loin de la lassitude et de la mauvaise humeur. A peine arrivé, il suit distraitement une femme dont le parfum – poivre et cannelle - l’attire. Quand elle se retourne, il reconnaît Garance, la petite amoureuse de son adolescence. A ses côtés, Jean va arpenter de nouveau une géographie sentimentale, qui n’a jamais cessé de le hanter, et se souvenir d’Yvonne.
Qui est Yvonne ? La mère de Garance et le cœur battant des Moustaches de Staline, roman dont la petite musique, mêlant grains de folie et ombres tristes, nous rappelle une chanson de Charles Trenet : « Que reste-t-il de nos amours / Que reste-t-il de ces beaux jours / Une photo, vieille photo / De ma jeunesse … »
Chez Cérésa, auteur qui se moque des genres et passe avec légèreté du roman historique à la chronique des amours défuntes, on croise Trenet, des écrivains infréquentables et Sagan, Chet Baker et la Callas ou encore des stars d’Hollywood, seules étoiles pouvant être comparées, dès sa première apparition, à la grâce pimentée d’Yvonne : « Elle portait un débardeur et un short rose. Moi, j’étais sur mon vélo, un peu en retrait, pétrifié. J’avais treize ans, elle vingt de plus. Elle ressemblait à Candice Bergen dans La canonnière du Yang Tsé. »
Les amours de jeunesse ne meurent jamais
S’il embrassait Garance, l’après-midi, au Club Mickey, Yvonne était l’unique obsession de Jean, comme elle obsédait tous les hommes de son entourage : Paul, son mari lunaire et caustique, Tom, son amant ex pilote de l’US Air Force, et une petite cour mêlant mondains, artistes et intellectuels. Trente-cinq ans plus tard, son obsession est identique. A chaque lieu revisité – une villa baptisée « la Colline », des dunes, un casino, le camping où lui, le fils de prolo, passait ses vacances – , Yvonne surgit avec la beauté détachée et un brin perverse des mannequins des années 70 : « Sur la plage, quand elle lisait Truman Capote, Fitzgerald et Graham Greene, elle portait un chemisier transparent, un bikini noir et des chaussures de tennis sans lacets. La pointe de son pied dessinait des cercles par terre. Eclaboussée de blondeur, elle restait ainsi. Pleine de mélancolie et de ferveur. Insaisissable et fulgurante. »
Tandis que Jean s’oublie dans le souvenir d’Yvonne – l’art qu’elle avait de mener son monde à la baguette de son charme-, Garance demande un baiser comme autrefois. Elle lui en veut de préférer sa mère. Elle en veut aussi à sa mère de lui avoir préféré les hommes. Elle s’attache à rectifier son portrait : « Ici, à Cabourg, dans ce paradis perdu qui avait été sa vie, son enfance, sa jeunesse, elle paraissait être à la recherche des mots les plus durs pour qualifier les sentiments les plus doux. »
Jean sait qu’Yvonne a semé la mort autour d’elle, mais il s’en moque. Sous la plume de Cérésa, l’héroïne de ses plus tendres saisons incarne un monde d’avant qui tire, avec style, ses ultimes cartouches, un monde où de jeunes femmes frivoles, parées d’un bikini blanc à pois rouges, pouvaient écrire un roman titré Trois jours en juin – salué par Jean Cau et Pascal Jardin- et où le jardin d’une villa en bord de mer était appelé : Les moustaches de Staline.
François Cérésa, Les moustaches de Staline, Fayard, 258 pages, 2008.
Article paru dans L'Opinion indépendante, le 05/09/2008
 Le plaisir sur le ouèbe, c'est http://chroniquesmarignac.blogspot.com/
Le plaisir sur le ouèbe, c'est http://chroniquesmarignac.blogspot.com/