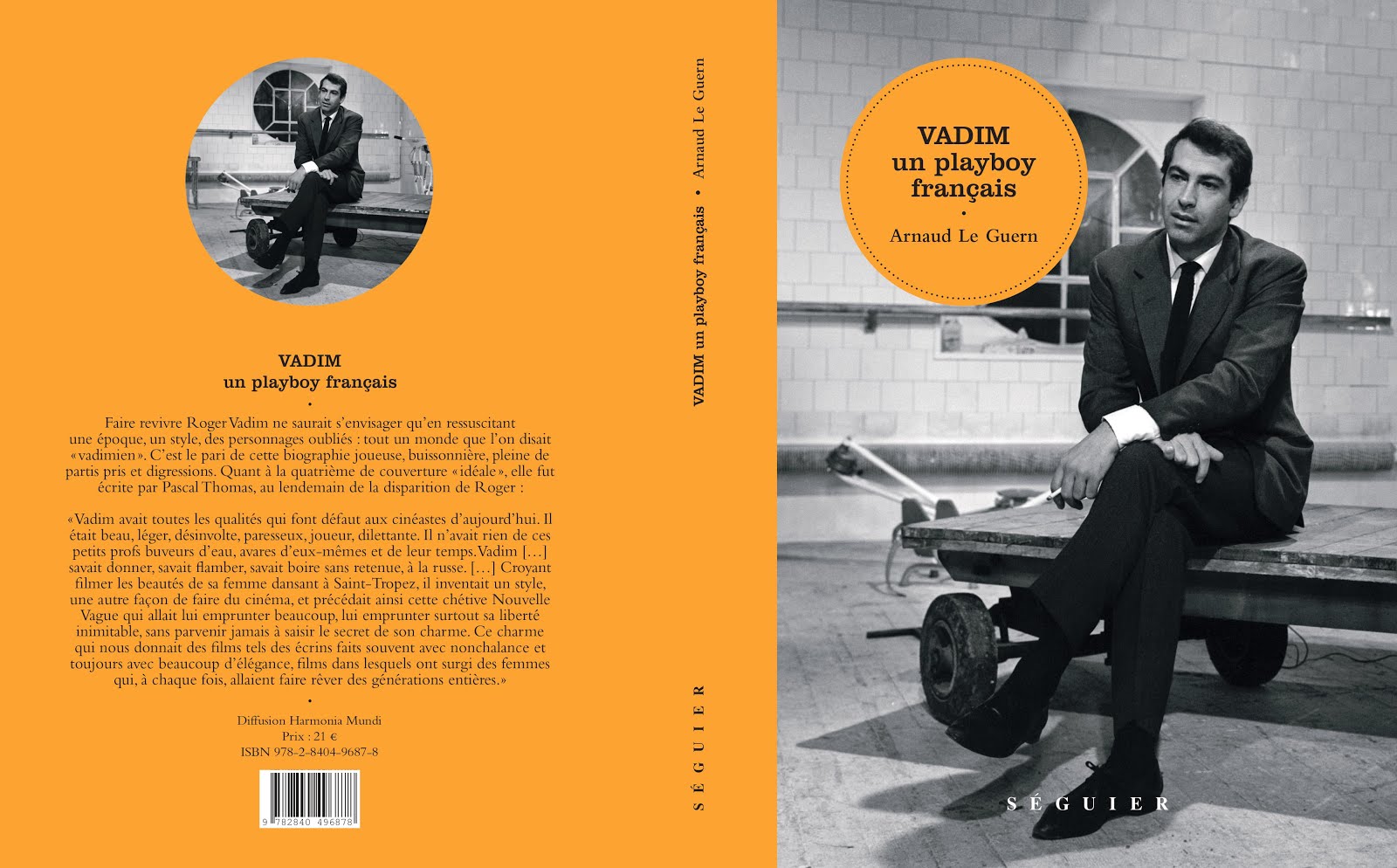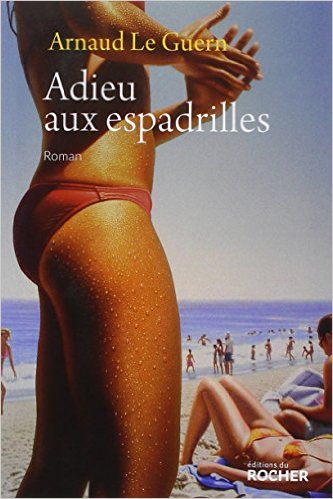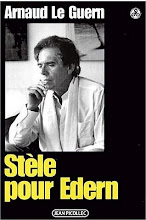mercredi 27 octobre 2010
Le style, c'est l'homme (#2 Frédéric Beigbeder)

mercredi 20 octobre 2010
Chocolates pour Pamela Moore

lundi 18 octobre 2010
Le style, c'est l'homme (#1 Gabriel Matzneff)
 Parler de Matzneff, Les émiles de Gab la rafale. Dans le roman électronique de ses mèles de jour, de nuit : ses héroïnes comme dans Ivre du vin perdu, comme dans ses Carnets noirs ; son style, comme lorsqu'il défile pour Yamamoto. Ca énerve toujours les pieds pensants, Matzneff. Le style aussi, d'ailleurs. Et se souvenir du Dîner des mousquetaires, acheté après avoir entendu l'auteur au Jean Edern's club. C'était quelque chose les papiers de Matzneff dans L'idiot International. Penser à reparler d'Hallier, ça fait longtemps. Il aurait écrit sur Sarko, Woerth, Bettencourt un roman toni-truand. Il l'a écrit en fait : ça s'appelle Les puissances du mal. Hallier, cette fripouille flamboyante, est à relire.
Parler de Matzneff, Les émiles de Gab la rafale. Dans le roman électronique de ses mèles de jour, de nuit : ses héroïnes comme dans Ivre du vin perdu, comme dans ses Carnets noirs ; son style, comme lorsqu'il défile pour Yamamoto. Ca énerve toujours les pieds pensants, Matzneff. Le style aussi, d'ailleurs. Et se souvenir du Dîner des mousquetaires, acheté après avoir entendu l'auteur au Jean Edern's club. C'était quelque chose les papiers de Matzneff dans L'idiot International. Penser à reparler d'Hallier, ça fait longtemps. Il aurait écrit sur Sarko, Woerth, Bettencourt un roman toni-truand. Il l'a écrit en fait : ça s'appelle Les puissances du mal. Hallier, cette fripouille flamboyante, est à relire.
mardi 12 octobre 2010
Jour de grève
C'était un jour de grève. Il y avait eu une nuit d'avant presque blanche, le dévédé d'un film naïf et grave de Pascal Thomas, du bruit et des larmes aussi, toujours trop. Au petit matin, un aller-retour dans une clinique, Paris 16e. Puis le sourire fatigué et apaisé de ta silhouette si belle. En terrasse, autour de midi, le calme et la tranquilité de la langue. Carrefour d'Alesia, les flics enfilent leur costume de kevlar et le rouge des drapeaux de la CGT colorent les cars. Ce rouge-là, c'est la couleur d'un monde qui ne veut juste pas qu'on l'achève d'une balle dans la tête. Ce rouge-là et ce monde, dans le froid d'un automne où les lunettes noires ont encore leur place, me font penser, allez savoir pourquoi, à Plein Soleil. Peut-être parce que les notes de Nino Rota ; la courte apparition de Romy Schneider ; les dialogues au couteau et à la caresse de Paul Gégauff ; Alain Delon et Maurice Ronet, c'est-à-dire les deux plus grands acteurs qu'a connu le cinéma français - et tant pis pour les autres ; Marie Laforêt s'offrant sur le pont du Marge ; le port de Mongibello ; les ivresses de nuit qui font se moquer des "bonnes femmes" et piquer des cannes blanches ; j'en oublie. Revoir Plein soleil, finalement, c'est sans doute se souvenir que ce monde, et le peu de beauté qui s'y planque, ne doit pas crever.
lundi 11 octobre 2010
L'éducation sentimentale selon Larry Clark
Jeune homme, jeune fille,
La Mairie de Paris et le très libéral Christophe Girard ne souhaitent pas que vous puissiez admirer les photos de Larry Clark au musée d'Art moderne.
"Un musée, ce n'est pas un sex shop" dixit Girard.
La Mairie de Paris vous accepte à la Techno Parade, à la Gay Pride, à la Rollers Day, à la Capote Hours, à la Fête de la musique, aux soirées Guetta et même à la Nuit blanche.
Mais Larry Clark, ses clichés de soufre et de sensualité, de doutes et de petites misères adolescentes, c'est non.
Il vous reste alors les dévédés, qui sont en train de devenir de précieuses vieilleries du monde d'avant.
Il vous reste les films de Larry Clark, Kids, Another day in Paradise et Ken Park.
Dans Ken Park, il y a tout ce qu'on vous interdit de voir au musée d'Art moderne : les désirs naissants, les corps qui se découvrent amoureux, la violence des jours et des nuits, les sorties de route dans les enfers intimes, les peaux qui s'aimantent, se mêlent, jouissent, la beauté des éducations sentimentales.
Dans Ken Park, jeune homme, jeune fille, Larry Clark parle de vous comme personne.
jeudi 7 octobre 2010
Hussards toujours vivants, Jean-François Coulomb suit ...



Aujourd’hui, n’importe quel plumitif intenterait, pour une telle assertion, une action en justice. A l’époque, rien. Au contraire, tous ont salué le talent de Bernard Frank, refusant seulement de se voir encager dans un groupe. Jacques Laurent précisa qu’il préférait les fantassins aux « hussards » et Martine Carol, adorable Caroline chérie, à tout le reste. Pendant la guerre d’Algérie, les « hussards » aggravèrent leur cas, avec quelques autres dont le maquisard et flibustier Jacques Perret, en attaquant, plume à l’assaut, de Gaulle rebaptisé « La grande Zorah ». La cause était perdue ; la défaite fut pleine de panache, c’est-à-dire riche en textes de grand style. Mauriac sous de Gaulle de Laurent et Le Vilain temps de Perret restent des chefs-d’œuvre de pamphlets, tous deux condamnés pour une exquise infamie : offense au chef de l’Etat.
Destinés à cramer la vie le souffle au cœur puis à se retirer pour un très long moment dans une maison de famille, un bar de palace ou en bord de mer, les « hussards » n’existent pas. Ils ne s’appréciaient pas forcément les uns les autres, ne se fréquentaient, à l’occasion, que dans les colonnes des mêmes revues – La Table ronde, Arts, La Parisienne notamment. En somme, ils n’ont été que la géniale invention d’un Bernard Frank qui se cherchait une place au soleil. Ce qui est facile à comprendre quand on le lit : « Ils aiment les femmes (Stendhal, Elle), les autos (Buffon, Auto-Journal), la vitesse (Morand), les salons (Stendhal, Proust), les alcools (un peu tout le monde), la plaisanterie (leur mauvais goût). »
La définition est plaisante. Sartre est renvoyé dans les cordes. Sagan se faufile avec son Bonjour tristesse. Roger Vailland – communiste, libertin, alcoolique et drogué au regard froid – n’est pas loin non plus.
Au milieu des années 1980, Jérôme Garcin crut reconnaître des « néo-hussards » : Patrick Besson, Eric Neuhoff, Denis Tillinac et Didier Van Cauwelaert. Pourquoi pas, même si Tillinac était enterré en Corrèze et Van Cauwelaert inconnu au bataillon des mots. Besson et Neuhoff, par contre, furent d’une belle aventure qui ne s’est pas privée de saluer Frank, Nimier, Blondin et Laurent : la revue Rive droite.
C’était en 1990. Ça a duré quatre numéros avec, pour éditeur, Thierry Ardisson – alors romancier inspiré et pas encore animateur pubard en bout de course. Au sommaire : Frébourg, Saint-Vincent, Parisis, Leroy, le trop oublié Jean-Michel Gravier ou encore Frédéric Fajardie. Mais aussi Jean-François Coulomb, homme de télé, de presse écrite, de ce qui lui plaît. Coulomb offrit à Rive droite une histoire d’amour triste sur fond de bataille napoléonienne : "Paris-Austerlitz". Vingt ans après, cette nouvelle clôt Vendanges tardives, petit livre hors saison qui rend plus léger l’automne naissant. En exergue de ce recueil de quatorze textes ciselés en puncheur orfèvre de la langue française, deux clins d’œil, à Bernard Frank – « L‘insolence consiste à écrire peu » – et à Patrick Besson : « Aucun problème ne résiste à la vodka- pamplemousse ».
Qu’il situe son récit à Paris, en Egypte ou dans un cimetière, Coulomb pose son ambiance comme il sifflerait une coupe de champagne, poursuit son intrigue tantôt en douceur tantôt pied au plancher et soigne ses chutes, toutes des banderilles de grâce cruelle. Il arrive que ses héros reviennent d’une guerre en Irak. Ou qu’ils boivent des daiquiris à la santé d’Hemingway, au Floridita de La Havane. Ou qu’ils ressemblent à Romain Gary juste avant l’ultime bye-bye, regardant une jeune demoiselle lire un de ses livres. Ils cachent leurs blessures derrière des lunettes noires et sous un costume en lin froissé. N’attendant rien, ils n’espèrent pas davantage. Ils ne croient plus en l’amour, ce chien de l’enfer. Puis ils y croient encore un peu, forcément. La faute à des héroïnes inoubliables. Chez Coulomb, elles s’appellent Aglaé et Alix de Chanturejolles, jumelles coquines ; Zelda ; Constance ; Carla ; ou Olympe de Vinezac.
L’apparition d’Olympe, aux premières lignes de Vendanges tardives, c’est Ursula Andress sortant des flots dans James Bond 007 contre Dr No : « Olympe est nue. Elle sait que je la regarde. Allongée sur le ventre, sa main effleure l’eau de la piscine. L’air sent la lavande. Sous le soleil, les oliviers ont des reflets d’argent. C’est l’heure de la sieste. La chaleur fige tout. Seules les cigales s’agitent. Délicieusement dorée, Olympe de Vinezac a un corps parfait. Digne du ciseau de Canova. D’un geste lent, elle essuie quelques gouttes de sueur qui perlent sur sa nuque. Entoure sa tête de ses bras. Ecarte légèrement les jambes, comme pour mieux se caler sur le matelas. Elle s’offre, pour ne pas avoir à s’abandonner ».
Jean-François Coulomb se lit et se relit comme une ivresse à prolonger, comme un auteur précieux à ranger, dans sa bibliothèque, près de quelques autres qui, eux aussi, savent que la passion des femmes, des paysages, de la vitesse, de la lenteur, de l’alcool et des plaisanteries mélancoliques, c’est l’ultime art de survivre en milieu hostile.
Jean-François Coulomb, Vendanges tardives, L'Editeur, 2010
Papier paru sur Causeur.fr, le 6 octobre 2010
lundi 4 octobre 2010
Colis suspects


 Evidemment les autorités anglaises et américaines ont raison de mettre en garde leurs ressortissants contre les risques encourrus s'ils avaient l'idée de flâner du côté de notre "cher et vieux pays".
Evidemment les autorités anglaises et américaines ont raison de mettre en garde leurs ressortissants contre les risques encourrus s'ils avaient l'idée de flâner du côté de notre "cher et vieux pays".Aube d'octobre

D'un baiser, sortir de la nuit, goûter l'aube contre tes lèvres.
Te regarder, parée de noir et des nuages fatigués du matin, tracer la ville, filer si loin.
Sniffer l'air froid par la fenêtre, laisser les gouttes effleurer le visage, se souvenir du miracle vivant et chaud de ta peau, de ton coeur du monde où se perdre, se retrouver.
Café, cigarettes, le chat Pablo, quelques mots.
Ecouter Christophe, Main dans la main, parce que ça mélodise la légèreté, la profondeur des émotions.
Glaner sur le ouèbe les niouzes insignifiantes d'un 4 octobre, la langue morte d'un hortefeux, d'un mauvais besson, chercher l'antidote, feuilleter Journal d'un homme perdu de Roland Jaccard, ce volume où il évoque la mort de Gégauff, lire "La seule chose qui m'apaise, c'est l'amour que je porte à L. et le bien-être que j'éprouve à vivre à ses côtés" et se dire qu'il est l'heure de glisser dans le lecteur dévédé du PC La collectionneuse d'Eric Rohmer.
Parce que l'été pas encore mort, parce que Patrick Bauchau, parce que la silhouette et les jambes de Mijanou Bardot dans l'herbe d'une maison de campagne, parce que Haydée Politoff en maillot de bain, en caraco, avec ses espadrilles ou pieds nus, bronzée et moue boudeuse, yeux rieurs, parce que la langue française, toujours, sur l'écran noir de nos fins de nuits blanches, sonne ainsi, beauté beau soucis des derniers aristocrates et des amoureux dilettantes et stylés.
Mais, au fait, qu'est devenue Haydée Politoff ?
vendredi 1 octobre 2010
La Peau Douce
_ Tu n'en as pas marre de tes vieilleries, tes lointaines nouvelles vagues, tes actrices oubliées des 80's ?
_ Les mots et la peau, alors, étaient à la fête.
_ Mais tout le monde s'en fout de ces époques-là !
_ "Tout le monde" est un con et "tout le monde" je l'empapaoute, grave.
_ Tu pourrais montrer ce qui se passe aujourd'hui.
_ Les mots d'hier - ceux de Godard, de Gégauff, de Truffaut, d'Audiard, de Pascal Jardin - et les silhouettes qui les portent, me parlent aujourd'hui. C'est ma mémoire vivante dans la ruine des paysages et des sens écorchés.
_ Langue morte et héroïnes démodées !
_ Tout ce qui reste de la vie et des envies, c'est cette jeune fille qui danse et cet homme qui lui dit : "Je vais te regarder". Cette jeune fille à la cigarette entre les lèvres, robe noire et dos nu, la grâce précise de ses gestes et la mélancolie rieuse de ses yeux, sa peau douce. Cette jeune fille : Françoise Dorléac.