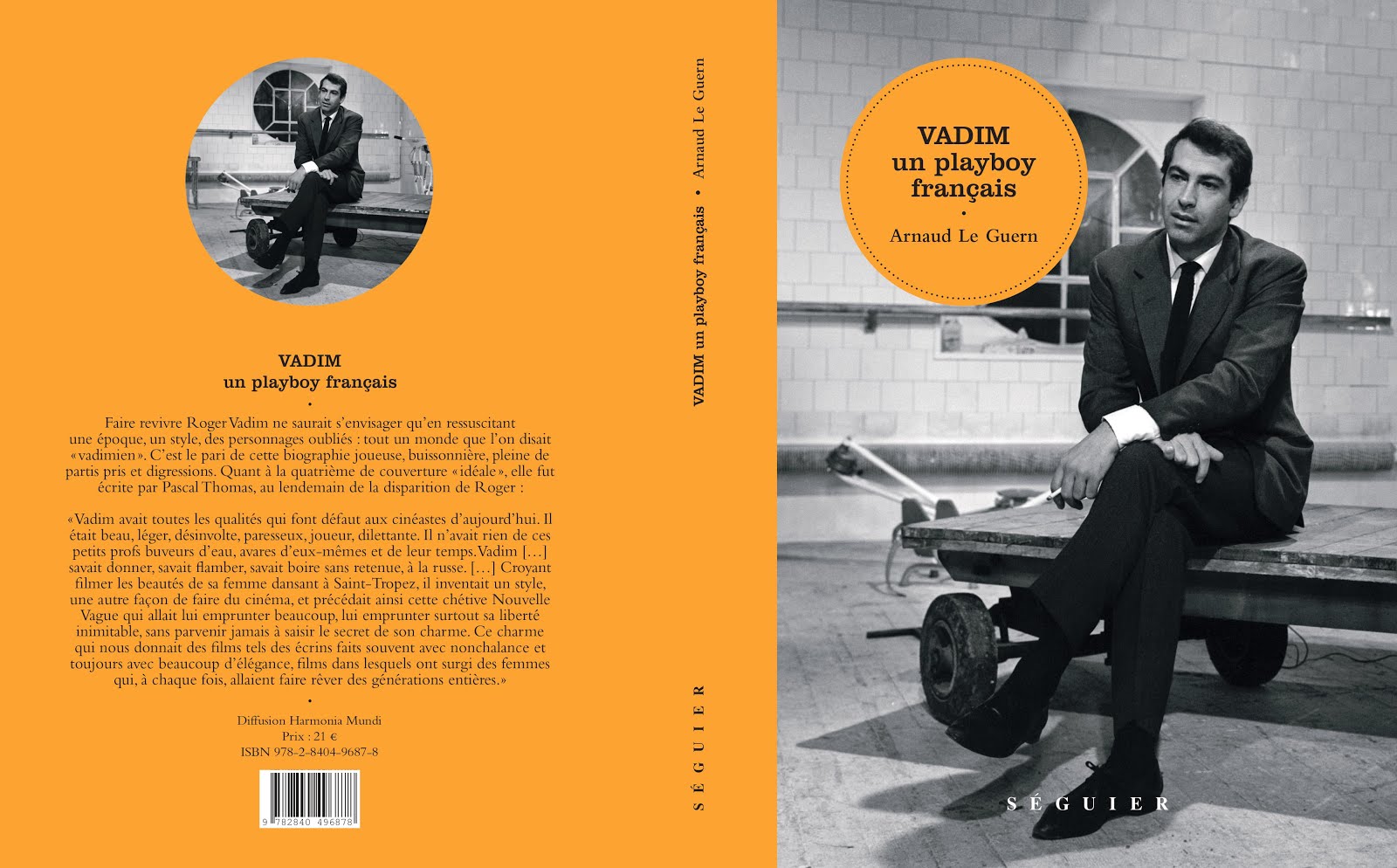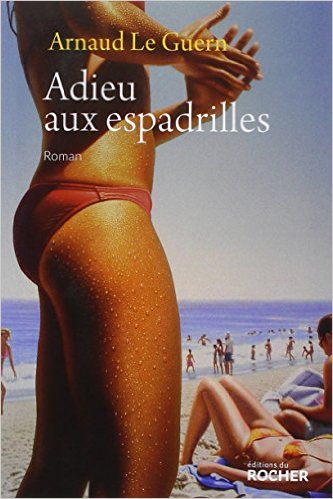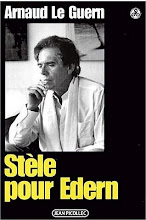Alors que France Tv diffuse l'adaptation, par Emmanuel Carrère, de Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte - sous le titre Fracture -, il faut relire urgemment le roman magnifique de Thierry Jonquet. Une vision noire et percutante des banlieues de notre « cher et vieux pays » dont j'avais parlé, à l'époque, dans L'Opinion indépendante.
Sous sa couverture noire au titre rouge sang, Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte de Thierry Jonquet nous parle d’une France en lambeaux. Un lopin de béton où tout est mal-en-point, les villes comme les corps. Nous sommes à Certigny dans le 9/3. Certigny et ses quartiers aux noms anonymes post-modernes : les Sablières, les Grands-Chênes, la Brêche-aux-loups. Dans des immeubles qui pourrissent, les corps s’entassent. Des Blacks, des Arabes, quelques Blancs. A Certigny, chacun cherche à fuir l’ennui qui, comme les ferrailleurs du jour, repeint l’âme en gris. Les plus vieux picolent en rentrant d’un boulot qu’ils n’aiment pas. Ils matent – un peu honteux - des revues porno pour oublier une femme repartie au bled. D’autres trafiquent – dans la drogue ou la prostitution. D’autres encore, de plus en plus nombreux et de tous âges, prient en s’imaginant à Bagdad sous les bombes, ou à Gaza. Le Djihad, pour eux, est ici et maintenant, au cœur de la cité. Même les plus jeunes y croient en lisant des brochures interdites à la vente ou en regardant sur Internet les têtes tranchées des «croisés». Face aux flics de la BAC, face aux CRS, ce sont des guerriers du cocktail Molotov et de la voiture qui flambe.
Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte met en scène des voix qui se frôlent mais s’accordent rarement. Des voix dont le seul lien paraît être le désespoir. Une mère dépressive se voit refuser l’internement de son fils, avant que celui-ci ne décapite sa voisine. Des gamins accros à la Star Academy s’envoient, sur leur téléphone portable, des clichés de la tête du cadavre. Un substitut du Procureur, fin lecteur de Hugo et de Marx, jure d’avoir la peau des caïds du quartier. Les mêmes caïds, aveuglés par leur petite gloire locale, s’éliminent les uns les autres, laissant la place à des « Grands frères » qui ne rêvent que d’Apocalypse. Dans la cour du collège Pierre-de-Ronsard, des Blacks cognent des Arabes au nom de la cause du peuple noir. Au nom d’Allah et de l’Imam du quartier, les représailles ne tarderont pas. De retour en classe, tous se retrouvent pour désigner les responsables de leurs malheurs : « Les feujs ! ». Mais qui sont les « feujs », demande une jeune professeur de français ? La réponse fuse : « Ceux qui nous pourrissent la vie ! Ceux qui tuent des enfants musulmans ! ». La prof ne trouve rien à répondre. Elle se souvient des récits de son père juif athée militant et des « Mort aux juifs ! » entendus, il y a peu, lors d’une manifestation contre la guerre en Irak. Autour d’elle, la plupart de ses collègues se taisent. La gêne, le ras-le-bol, l’envie d’en finir avec un quotidien impossible. Quant à ceux qui parlent, ils n’ont, en bouche, que des mots d’ordre syndicaux et des désirs de pétitions.
Chez Jonquet, les nerfs sont à vif et le bitume sent la poudre. Un fait-divers tragique allumera la mèche : la mort de deux jeunes garçons, électrocutés après une course-poursuite avec la police. C’est désormais le temps des pierres, des flammes et des vengeances inutiles. Blacks, Arabes ou Blancs, « feujs » ou musulmans, tous seront bientôt perdus définitivement. Emportés par l’horreur triste des jours criminels.
Sous sa couverture noire au titre rouge sang, Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte de Thierry Jonquet nous parle d’une France en lambeaux. Un lopin de béton où tout est mal-en-point, les villes comme les corps. Nous sommes à Certigny dans le 9/3. Certigny et ses quartiers aux noms anonymes post-modernes : les Sablières, les Grands-Chênes, la Brêche-aux-loups. Dans des immeubles qui pourrissent, les corps s’entassent. Des Blacks, des Arabes, quelques Blancs. A Certigny, chacun cherche à fuir l’ennui qui, comme les ferrailleurs du jour, repeint l’âme en gris. Les plus vieux picolent en rentrant d’un boulot qu’ils n’aiment pas. Ils matent – un peu honteux - des revues porno pour oublier une femme repartie au bled. D’autres trafiquent – dans la drogue ou la prostitution. D’autres encore, de plus en plus nombreux et de tous âges, prient en s’imaginant à Bagdad sous les bombes, ou à Gaza. Le Djihad, pour eux, est ici et maintenant, au cœur de la cité. Même les plus jeunes y croient en lisant des brochures interdites à la vente ou en regardant sur Internet les têtes tranchées des «croisés». Face aux flics de la BAC, face aux CRS, ce sont des guerriers du cocktail Molotov et de la voiture qui flambe.
Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte met en scène des voix qui se frôlent mais s’accordent rarement. Des voix dont le seul lien paraît être le désespoir. Une mère dépressive se voit refuser l’internement de son fils, avant que celui-ci ne décapite sa voisine. Des gamins accros à la Star Academy s’envoient, sur leur téléphone portable, des clichés de la tête du cadavre. Un substitut du Procureur, fin lecteur de Hugo et de Marx, jure d’avoir la peau des caïds du quartier. Les mêmes caïds, aveuglés par leur petite gloire locale, s’éliminent les uns les autres, laissant la place à des « Grands frères » qui ne rêvent que d’Apocalypse. Dans la cour du collège Pierre-de-Ronsard, des Blacks cognent des Arabes au nom de la cause du peuple noir. Au nom d’Allah et de l’Imam du quartier, les représailles ne tarderont pas. De retour en classe, tous se retrouvent pour désigner les responsables de leurs malheurs : « Les feujs ! ». Mais qui sont les « feujs », demande une jeune professeur de français ? La réponse fuse : « Ceux qui nous pourrissent la vie ! Ceux qui tuent des enfants musulmans ! ». La prof ne trouve rien à répondre. Elle se souvient des récits de son père juif athée militant et des « Mort aux juifs ! » entendus, il y a peu, lors d’une manifestation contre la guerre en Irak. Autour d’elle, la plupart de ses collègues se taisent. La gêne, le ras-le-bol, l’envie d’en finir avec un quotidien impossible. Quant à ceux qui parlent, ils n’ont, en bouche, que des mots d’ordre syndicaux et des désirs de pétitions.
Chez Jonquet, les nerfs sont à vif et le bitume sent la poudre. Un fait-divers tragique allumera la mèche : la mort de deux jeunes garçons, électrocutés après une course-poursuite avec la police. C’est désormais le temps des pierres, des flammes et des vengeances inutiles. Blacks, Arabes ou Blancs, « feujs » ou musulmans, tous seront bientôt perdus définitivement. Emportés par l’horreur triste des jours criminels.